L’AVC : agir vite pour sauver le cerveau, à tout âge
Imaginez : un matin, vous vous levez et votre bras refuse de bouger, votre bouche est asymétrique ou vous avez du mal à parler. Chaque minute compte. Vous êtes peut-être en train de vivre un AVC... Lire la suite
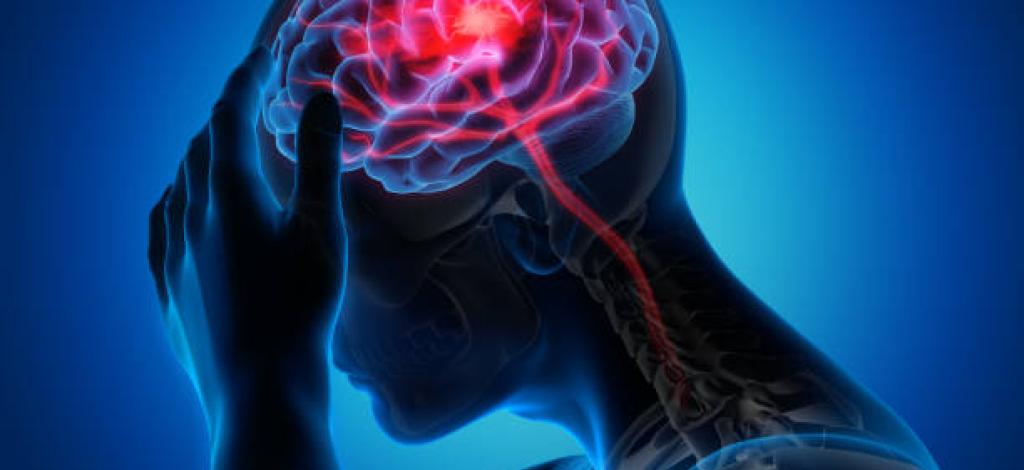
Interview du Dr. Noémie Ligot, Directrice de la Clinique Neurovasculaire de l'H.U.B
Imaginez : un matin, vous vous levez et votre bras refuse de bouger, votre bouche est asymétrique ou vous avez du mal à parler. Chaque minute compte. Vous êtes peut-être en train de vivre un AVC. Et ce n’est pas rare : selon les données mondiales (GBD/OMS, 2018), une personne sur quatre âgée de plus de 25 ans subira un AVC au cours de sa vie.
Qu’est-ce qu’un AVC ?
Un AVC, ou accident vasculaire cérébral, se produit lorsqu’une région du cerveau ne reçoit plus l’oxygène et les nutriments dont elle a besoin. Deux types principaux existent :
- L’AVC ischémique (85 % des cas) : un caillot bloque une artère, empêchant le sang d’atteindre certaines zones du cerveau.
- L’AVC hémorragique (15 %) : une artère se rompt et provoque un saignement dans le cerveau.
Qu’il s’agisse d’un AVC ischémique ou hémorragique, les signes sont identiques : difficulté à parler, faiblesse d’un bras ou d’une jambe, perte ou trouble de la vision. Seul un scanner ou une IRM permet de faire la différence.
L’AIT : un signal d’alerte
Un AIT, ou accident ischémique transitoire, se manifeste comme un AVC mais disparaît rapidement, souvent en moins d’une heure. Bien que les symptômes s’estompent vite, il s’agit d’un signal d’alarme : le risque d’AVC majeur dans les jours suivants est élevé. Il faut agir immédiatement.
Comment reconnaître un AVC ou un AIT ?
La règle d’or : F.A.S.T
- Face : affaissement d’un côté du visage
- Arm : faiblesse d’un bras ou d’une jambe
- Speech : troubles de la parole ou du langage
- Time : chaque minute compte, appelez immédiatement le 112
Tout déficit neurologique soudain — vision trouble, vertiges, engourdissement d’un membre — doit être pris au sérieux et conduit directement aux urgences, même s’il disparaît rapidement.
“Même s’il semble passer, il indique souvent un risque imminent d’AVC plus grave. Il faut aller immédiatement aux urgences. Chaque minute compte pour protéger le cerveau”, rappelle le Dr. Noémie Ligot, Directrice de la Clinique Neurovasculaire de l’Hôpital Universitaire de Bruxelles
Dans la suite de cet article, nous parlerons surtout de l’AVC ischémique, le plus fréquent, et aussi celui pour lequel il existe aujourd’hui des traitements spécifiques en phase aiguë.
Les causes varient selon l’âge et l’état de santé :
|
L’AVC chez les jeunes : un message d’alerte
Les jeunes victimes d’AVC nécessitent une approche diagnostique spécifique : IRM du cerveau spécialisée, échographie cardiaque, doppler des artères du cerveau et bilan sanguin étendu. L’objectif est de comprendre la cause exacte pour adapter le traitement et prévenir une récidive. Dans certains cas, malgré une recherche exhaustive, aucune cause n’est retrouvée. Cela ne signifie pas qu’il n’y a pas de solutions : un suivi adapté et des mesures de prévention permettent de réduire fortement le risque de nouvel AVC.
Le Dr. Noémie Ligot insiste : « Même chez un jeune adulte sans facteur de risque classique, un AVC peut survenir. Il est essentiel de ne jamais minimiser les symptômes. »
Prise en charge et prévention de l’AVC : un parcours complet et rapide
Vous l’aurez compris, lorsqu’un AVC survient, le temps est un facteur clé. Plus vite le patient arrive à l’hôpital, plus grandes sont les chances de limiter les séquelles. À l'Hôpital Universitaire de Bruxelles, la prise en charge suit les standards internationaux les plus stricts, avec un parcours conçu pour être ultra-rapide, précis et efficace.
1. La phase aiguë : agir vite pour sauver le cerveau
Dès l’arrivée aux urgences, le patient bénéficie de :
- Un scanner cérébral, qui permet avant tout d’exclure une hémorragie mais aussi d’évaluer les premières lésions liées à l’ischémie, un angio-scan, pour localiser exactement le caillot et évaluer l’état des artères.
- Un scanner de perfusion, qui permet de distinguer les zones du cerveau encore sauvables de celles déjà irrémédiablement touchées.
Ces informations guident le traitement :
- La thrombolyse consiste à injecter dans les veines un médicament qui dissout le caillot. Elle doit être administrée le plus rapidement possible pour être pleinement efficace. Elle est en général réalisée dans les 4,5 premières heures, mais, grâce à l’imagerie de perfusion, certains patients peuvent encore en bénéficier jusqu’à 9 heures après le début des symptômes.
- La thrombectomie est une intervention endovasculaire qui retire le caillot directement dans l’artère, réservée aux occlusions des grosses artères du cerveau. Elle doit être réalisée le plus rapidement possible : plus l’intervention est précoce, plus elle est efficace. Elle est habituellement réalisée dans les 6 premières heures, mais, grâce à l’imagerie de perfusion, certains patients peuvent encore en bénéficier jusqu’à 24 heures après le début des symptômes. Ces interventions sont réalisées 24h/24, 7j/7, par une équipe spécialisée prête à intervenir immédiatement, même le week-end et la nuit.
2. Le suivi et la recherche de la cause
Une fois l’AVC stabilisé, la mise au point diagnostique est exhaustive :
- Imagerie détaillée pour détecter dissections, anomalies vasculaires ou infarctus silencieux.
- Bilan cardiaque pour rechercher une fibrillation atriale ou un foramen ovale perméable.
- Analyses sanguines pour détecter des troubles de la coagulation ou des facteurs inflammatoires.
“L’objectif est de comprendre précisément la cause de l’AVC, afin d’adapter le traitement et prévenir au mieux les récidives. Même si la cause n’est pas trouvée dans 100 % des cas, l’équipe peut déterminer la meilleure stratégie de prévention pour chaque patient”, explique le Dr. Ligot.
3. La rééducation et le soutien global
La récupération ne s’arrête pas à l’hôpital :
- Les patients bénéficient d’une rééducation adaptée (kinésithérapie, logopédie, ergothérapie, neuropsychologie) dès les premiers jours.
- Un suivi psychologique est proposé pour aider à surmonter le stress, l’anxiété ou la dépression liés à l’AVC.
- L’éducation du patient et de sa famille sur les facteurs de risque et la prévention est essentielle : hypertension, tabac, cholestérol, activité physique, alimentation équilibrée.
4. Un centre de référence unique
L’H.U.B. dispose d’une Stroke Unit de référence, avec :
- 10 lits monitorés dédiés à la surveillance des AVC.
- Des neurologues vasculaires et neuroradiologues interventionnels, formés et disponibles pour superviser chaque intervention.
- Une équipe multidisciplinaire (radiologues, urgentistes et infirmiers spécialisés, kinésithérapeutes, logopèdes, etc.) constamment formée aux techniques les plus récentes.
- Plus de 120 interventions de thrombectomie par an, ainsi qu’un suivi régulier des patients après AVC.
Depuis 2018, l’H.U.B. est reconnu par l’European Stroke Organisation (ESO) comme le premier centre certifié « Stroke Center » en Belgique, gage de qualité et de conformité aux standards internationaux. Cette organisation permet une prise en charge complète, rapide et pointue, adaptée aux besoins de chaque patient, qu’il s’agisse d’un jeune adulte ou d’une personne âgée.
5. Prévention : agir avant l’AVC
La prévention reste le pilier central :
- Contrôle des facteurs cardiovasculaires : tension, cholestérol, diabète, poids.
- Arrêt du tabac et limitation de l’alcool.
- Activité physique régulière, limitation du stress et alimentation équilibrée.
À retenir
|
sources : Feigin VL, Nguyen G, Cercy K, Johnson CO, Alam T, et al. Global, Regional, and Country-Specific Lifetime Risks of Stroke, 1990 and 2016.
New England Journal of Medicine. 2018;379(25):2429-2437. doi: 10.1056/NEJMoa1804492